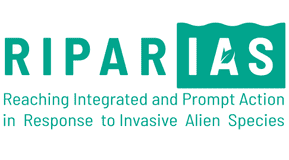Apprenez à reconnaître et limiter les espèces exotiques envahissantes
Plantes, animaux, insectes… Certaines espèces exotiques, lorsqu'elles deviennent envahissantes dans nos écosystèmes peuvent parfois avoir avec des conséquences graves. Elles concurrencent les espèces locales, dégradent les habitats, et peuvent même nuire à notre santé ou à l’économie. Découvrez les enjeux liés aux Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et les principales techniques de lutte.
.jpg)
Comprenez les enjeux
Les espèces exotiques envahissantes représentent aujourd’hui l’une des principales menaces pour la biodiversité à l’échelle mondiale car elles induisent une banalisation et une uniformisation du cortège d'espèces présentes dans nos milieux. Introduites volontairement ou accidentellement hors de leur aire d’origine, certaines de ces espèces parviennent à s’installer durablement dans de nouveaux milieux, où elles prolifèrent au détriment des espèces locales, modifient les écosystèmes et perturbent les équilibres naturels. Comprendre les mécanismes d’invasion biologique et l’impact de ces espèces sur notre environnement est essentiel pour mieux les prévenir.
Infos techniques
Identifiez la menace
Qu'est-ce qu'une "EEE", une espèce exotique envahissante ?
Une espèce exotique envahissante est une espèce animale ou végétale introduite par l'humain, volontairement ou non, en dehors de son aire de répartition naturelle, et dont la prolifération menace la biodiversité locale, l’économie ou la santé humaine.
L’introduction de ces espèces peut être accidentelle (via le transport maritime, les échanges commerciaux, etc.) ou intentionnelle (pour des raisons horticoles, ornementales, piscicoles, ou encore pour la lutte biologique en agriculture). Certaines de ces espèces s’acclimatent sans poser de problème, mais d’autres prolifèrent et ont un impact négatif sur leur nouvel environnement.
Ces espèces sont parfois nommées espèces "invasives", un anglicisme dérivé des "invasive alien species" (ou IAS). Ce terme est encore employé dans des textes juridiques plus anciens, mais la terminologie officielle et à privilégier est à présent espèces exotiques envahissantes (ou EEE).

Une liste européenne...
L’Union européenne a établi une liste de 88 EEE (à ce jour) de préoccupation européenne, qui doivent faire l’objet de mesures de prévention et de gestion. Parmi les espèces concernées, on trouve par exemple :
- Végétaux : jussie, berce du Caucase, myriophylle du Brésil...
- Animaux : raton-laveur, écrevisse signal, tortue de Floride, perche soleil, frelon asiatique...
... et une liste régionale
En Région de Bruxelles-Capitale, la législation régionale disposait déjà d'une liste d’espèces préoccupantes figurant à l’annexe 4 de l’Ordonnance relative à la conservation de la nature» de 2012. Elle inclut certaines espèces qui ont un impact spécifique sur les milieux naturels bruxellois. On y retrouve entre autres :
- Végétaux : renouées asiatiques, laurier cerise, cotonéaster horizontal, robinier faux-acacia...
- Animaux : bernache du canada, ouette d'Egypte, coccinelle asiatique, conure veuve, perruches Alexandre et à collier, raton-laveur, ragondin, rat musqué, grenouille rieuse, écureuil de Corée...
- La liste bruxelloise est antérieure à la liste européenne. Des adaptations juridiques sont en cours via un projet d'ordonnance dédiée.
Découvrez nos fiches sur les plantes exotiques envahissantes
Et nos fiches sur les animaux exotiques envahissants
Pourquoi est-ce un souci ?
Un phénomène mondial en expansion
Il existe dans le monde plus de 37.000 espèces exotiques recensées, dont 3.500 envahissantes avec 200 nouvelles espèces exotiques enregistrées chaque année dans des régions et des biomes du monde entier selon l'IPBES, le "GIEC" de la biodiversité. Tous les milieux sont touchés : terrestres, aquatiques ou marins, que ce soit en ville, à la campagne ou en pleine nature.
Les espèces exotiques envahissantes posent plusieurs problèmes majeurs.
Dégradation et perte de biodiversité
Les invasions biologiques sont l'une des 5 causes majeures du déclin de la biodiversité, souvent sous-estimée. Elles entrent en compétition avec les espèces indigènes, modifient les écosystèmes et peuvent causer l’extinction d'espèces locales. De plus, elles participent à la destruction d’habitats et perturbent des fonctions écologiques (pollinisation, qualité de l’eau…).
Quelques exemples:
- La jussie (Ludwigia grandiflora) peut coloniser massivement les plans d’eau et former des tapis végétaux denses à la surface. Cette couverture empêche la lumière de pénétrer jusqu’aux couches inférieures, réduisant la photosynthèse des espèces aquatiques locales. Cela provoque une chute du taux d’oxygène dissous (hypoxie), pouvant aller jusqu’à l’anoxie (souffrance cellulaire liée à la privation d'oxygène), et conduit à l’asphyxie progressive de l’écosystème aquatique.
- La perche soleil (Lepomis gibbosus), un petit poisson originaire d’Amérique du Nord, introduit chez nous pour l’aquariophilie ou la pêche de loisir. Elle se reproduit facilement, mange les œufs et les larves des poissons locaux, et entre en compétition avec eux pour la nourriture. Résultat : les espèces indigènes déclinent, certaines disparaissent même, et on se retrouve avec des milieux appauvris, moins diversifiés, où les équilibres écologiques sont perturbés.
- L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) a été introduite pour la consommation et l’aquariophilie. Très résistante et prolifique, elle colonise rapidement les milieux aquatiques, où elle détruit la végétation, s’attaque aux amphibiens, aux poissons et aux œufs, et entre en concurrence avec les écrevisses locales, comme l’écrevisse à pattes rouges. Elle contribue aussi à la dégradation des berges par ses galeries, ce qui fragilise les habitats.
- La renouée du Japon (Reynoutria japonica) pousse très vite, forme des colonies denses qui étouffe littéralement les autres plantes. À force, elle uniformise le paysage, réduit la diversité végétale (réduction et homogénéisation du couvert), et fragilise les écosystèmes en place (perte des habitats). En plus, elle modifie la structure du sol et peut accentuer l’érosion, notamment en bord de cours d’eau. Cette emprise physique est renforcée par la libération de substances allélopathiques, c'est à dire de substances inhibant la germination et la croissance d’autres plantes.

Impact économique
Elles occasionnent des coûts importants en gestion et en réparation des dégâts causés (ex. obstruction des cours d'eau, dégradation des infrastructures). En plus d’engendrer des couts coûts énormes pour l’agriculture, les infrastructures et la santé humaine. Ce sont des pertes comparables à celles causées par des catastrophes naturelles. Par exemple, la prolifération des écrevisses invasives entraîne des pertes pour la pêche locale et endommage les berges des rivières.
Exemple : la moule zébrée (Dreissena polymorpha) répandue dans de nombreux cours d’eau en Europe, notamment via les eaux de ballast des bateaux. Une fois installée, elle se fixe partout : sur les coques de bateaux, les rochers, les installations portuaires… mais aussi à l’intérieur des canalisations et circuits de refroidissement des centrales électriques ou des stations de traitement d’eau. Elle forme rapidement des amas denses qui obstruent les conduites, réduisent les débits et obligent à des opérations de nettoyage et de maintenance coûteuses. Certaines installations doivent même être temporairement mises à l’arrêt. À grande échelle, cela représente des millions d’euros dépensés chaque année.
Risque pour la santé humaine et animale
Certaines EEE sont toxiques, vectrices de maladies ou provoquent des allergies. Par exemple, l'Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) est responsable de fortes réactions allergiques, tandis que la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) peut provoquer de graves brûlures cutanées en cas de contact avec la peau et l'exposition au soleil des zones ayant été en contact avec sa sève. Parmi les espèces animales, on peut citer le moustique tigre qui peut transmettre des maladies tropicales comme la malaria, la deugne ou zika.

Limitez l’introduction des EEE dans nos ecosystèmes
Les espèces exotiques envahissantes peuvent arriver dans un territoire par plusieurs voies, généralement liées aux activités humaines :
- Importation volontaire pour l'ornement, la culture ou la chasse.
- Transport accidentel.
- Évasion ou abandon d'espèces captives.
- Dispersion naturelle à partir de foyers d’introduction voisins.
La mondialisation des échanges et la mobilité croissante des personnes et des biens favorisent leur introduction et leur dissémination rapide.
Pour limiter les risques d'introduction d'une espèce
-
Choisissez des espèces locales pour l’aménagement.
Évitez d’introduire des plantes ou des animaux exotiques à des fins ornementales, horticoles, ou récréatives (aquariophilie, chasse, etc.). Privilégiez les espèces indigènes adaptées à l’écosystème local. - Contrôlez les flux de marchandises et de matériaux en veillant à la propreté des engins de chantier, au nettoyage des conteneurs, et à la décontamination des matériaux (terre, graviers, ballast...) susceptibles de transporter des graines ou des organismes vivants.
- Ne relâchez jamais vos animaux de compagnie, poissons d’aquarium ou plantes de bassin dans les milieux naturels : même s’ils semblent inoffensifs, ils peuvent déséquilibrer les écosystèmes.
- Mettez en place des installations sécurisées pour éviter les fuites accidentelles depuis les bassins, viviers, enclos ou autres structures contenant des espèces non indigènes.
- Soyez particulièrement vigilant dans les régions proches de sites déjà colonisés par des EEE, car celles-ci peuvent se propager naturellement par dispersion.

Découvrez les principales techniques de lutte contre les EEE
Une lutte difficile, mais possible
La prévention (biosécurité, surveillance, sensibilisation) est la solution la plus efficace et la moins coûteuse tout en sachant que retarder l’action augmente les coûts de lutte de millions d’euros par an. Il faut en plus savoir que le changement climatique qui rend nos écosystèmes plus vulnérables et la mondialisation qui multiplie les opportunités d’introduction, accélèrent le phénomène.
Différentes méthodes existent pour limiter la propagation des EEE :
Prévention
Sensibilisation du public, interdiction de commercialisation et de plantation de certaines espèces, contrôle des transports et des eaux de ballast.
Méthodes mécaniques
Que ce soit sur plan d’eau ou sur la terre ferme : arrachage manuel ou mécanique, fauchage régulier, faucardage, écorçage pour affaiblir certaines plantes.
Ces méthodes nécessitent une application répétée et un suivi rigoureux pour être efficaces, mais c'est l'approche à privilégier.
- N’oubliez pas les éventuels accords et/ou dérogation nécessaires pour effectuer ce type d’action entre autres dans les espaces sensibles et protégés (par exemple en Natura 2000).
Méthodes écologiques et de restauration
Restauration des milieux naturels (zones humides, ripisylves), replantation d’espèces locales compétitives après élimination d’EEE pour éviter la recolonisation, tout en pratiquant une gestion intégrée et différenciée (fauche raisonnée, réduction du sol nu).
Gestion écologique des habitats
Favoriser la résilience des écosystèmes en rétablissant les espèces indigènes ainsi qu’en encourageant la diversité des espèces, des habitats et des interactions écologiques pour renforcer la stabilité et la résilience des milieux naturels. Une gestion écologique intégrée des espaces verts et une restauration des zones humides permettent par exemple de limiter l’installation d’EEE.
Méthodes biologiques
- Surveillance des populations de prédateurs indigènes susceptibles de réguler certaines EEE, tout en évitant les effets indésirables sur les espèces locales.
- Introduction de prédateurs naturels sous contrôle scientifique et dans un cadre rigoureusement encadré. Il est essentiel d’éviter toute approche hasardeuse, car certaines introductions mal maîtrisées peuvent aggraver la situation au lieu de l’améliorer.
- L'introduction dans la nature d'organismes non indigènes ou de souches non indigènes d'espèces indigènes est soumise à autorisation par la Région.
Méthodes chimiques
Usage limité et contrôlé de pesticides, en dernier recours et sous conditions strictes, avec une attention particulière à l’impact sur les milieux naturels.
On distingue les produits biocides (désinsectisation, dératisation, etc.) utilisés dans la gestion d'animaux ou la protection des matériaux et personnes (désinfectants par ex.), et les produits phytopharmaceutiques (insecticides, herbicides, fongicides...) utilisés uniquement dans le cadre de la gestion des plantes.
- L'utilisation de produits biocides (gestion des animaux) est interdite dans les réserves naturelles, dans les habitats Natura 2000 et dans les zones de protection des captages d'eau (types I et II). Des dérogations sont nécessaires.
- L'usage de produits phytopharmaceutiques (gestion des plantes) est interdit, mais peut faire l'objet de dérogations pour la gestion des invasives par les professionnels ; cela nécessite toutefois une notification préalable.
Déterminez la bonne période pour agir
Quand agir ? Dès que possible et à tout moment, néanmoins, il est crucial d'adapter ses actions aux obligations légales et réglementaires en vigueur, telles que les périodes de nidification, afin de minimiser les impacts négatifs sur les habitats ainsi que sur la faune et flore locale. Il est également essentiel de prendre en compte le calendrier physiologique des espèces, c'est-à-dire les cycles de reproduction, de migration, et de développement des plantes et des animaux.
Par exemple, certaines interventions doivent être évitées pendant les périodes de reproduction pour ne pas perturber les espèces natives.
De même, les actions de gestion doivent être planifiées en fonction des saisons et des conditions climatiques pour maximiser leur efficacité et réduire les risques de propagation des espèces exotiques envahissantes ou encore pour réduire l’impact des actions de gestion sur l’environnement (par exemple la compaction du sol en zone Natura 2000).
Une approche intégrée sur le long terme, qui combine des mesures préventives et curatives, est souvent nécessaire. Ci-dessous un calendrier informatif reprenant les périodes de gestion à éviter.
Calendrier des périodes sensibles par groupes d'espèces

Passez à l'action avec RIPARIAS
Il est essentiel que chacun joue un rôle actif dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Chacun peut contribuer, à son échelle, en adoptant des gestes simples mais efficaces. L’idée du "colibri", où chacun fait sa part, est cruciale pour limiter leur propagation et protéger la biodiversité !
Passez à l’action
- Participez aux programmes de sciences participatives : signaler la présence d’EEE via des plateformes dédiées comme Observations.be , INaturalist ou les applications de suivi environnemental qui permettent aux autorités et chercheurs d’améliorer la gestion des invasions biologiques.
- Informez les autorités compétentes : en cas de découverte d’une espèce exotique envahissante dans un espace public, il est utile de le signaler aux services environnementaux locaux (aux services communaux si l'espèce se trouve dans un espace communal, à Bruxelles Environnement si elle se trouve dans un espace géré par la Région).
- Impliquez vous dans la gestion des milieux naturels : les associations environnementales et les collectivités locales organisent régulièrement des chantiers participatifs pour contrôler les EEE.
En adoptant ces gestes simples et en s’impliquant activement, nous contribuons tous à la préservation des écosystèmes et à la réduction de l’impact des espèces exotiques envahissantes en Région bruxelloise.
La lutte contre les EEE est une responsabilité collective : chaque citoyen, gestionnaire d’espaces verts ou collectivité peut agir pour limiter leur propagation et préserver la biodiversité bruxelloise via des actions concrètes:
- Ne plantez pas d’espèces exotiques envahissantes dans son jardin et privilégier des espèces locales.
- Évitez de relâcher des animaux exotiques (ex. tortues, poissons, plantes aquatiques) dans la nature.
- Participez aux actions locales de gestion des EEE, comme les campagnes d’arrachage organisées par les autorités ou les associations environnementales.
- Informez et sensibilisez votre entourage sur les risques des EEE et les bonnes pratiques pour les éviter.
Apprenez en plus sur la surveillance des EEE grâce au projet Life RIPARIAS
Le projet LIFE RIPARIAS (« Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species ») vise à optimiser la gestion de certaines espèces exotiques envahissantes en Belgique sur la période 2021-2026.
Il est coordonné par Bruxelles Environnement, en collaboration avec 10 partenaires présents dans les 3 régions de la Belgique. Ces partenaires proviennent d’organismes publics ainsi que des secteurs académique et associatif, tous engagés à travailler ensemble.
Il cible plusieurs espèces de plantes et écrevisses présentes en bordure de rivières et dans les étangs. Il se focalise sur une zone pilote interrégionale incluant les bassins versants de la Dyle, la Senne et la Marcq.
Il y a actuellement 88 espèces exotiques envahissantes répertoriées comme préoccupantes pour l’Union européenne. Parmi elles, 13 espèces de plantes et 4 d’écrevisses sont déjà répandues ou pourraient apparaître en Belgique. Ces dernières sont ciblées par le projet ainsi que 13 espèces inscrites sur une liste d’alerte belge.
Les actions de surveillance et de gestion seront coordonnées afin de maximiser leur efficacité. La participation active et la coopération entre les décideurs, les gestionnaires de terrain et le grand public seront essentielles à la réussite de ce projet.
Des brochures présentant le projet sont désormais disponibles ainsi que des fiches d’identification par espèce. Des guides de bonnes pratiques de gestion seront par ailleurs publiés d’ici à mi-2023 afin de faciliter la gestion de ces espèces invasives sur le terrain.
Des sessions de formation sont également prévues à partir de mi-2023 afin de partager les connaissances aussi largement que possible. Des opportunités de volontariat sont aussi envisagées: toute aide est la bienvenue ! Pour plus d’informations, visitez le site du projet.
Ce projet novateur est cofinancé par l’Union européenne et les 3 autorités régionales belges pour un budget total estimé à 7 millions d’euros. LIFE RIPARIAS a pu voir le jour grâce au financement du programme LIFE « Nature et Biodiversité ».
En résumé, le projet agit à plusieurs niveaux :
- Il développe une base de données partagée et harmonisée pour suivre les observations d’EEE.
- Il met en place des protocoles de surveillance standardisés et des outils numériques pour faciliter la prise de décision rapide.
- Il renforce la coopération entre les régions et les gestionnaires de terrain pour planifier des actions coordonnées.
- Il organise des campagnes de sensibilisation et de formation pour les professionnels, les bénévoles et le grand public.
- Il teste et évalue des méthodes de gestion écologique sur le terrain pour contenir ou éradiquer certaines EEE prioritaires.
Il contribue à rendre la lutte contre les EEE plus efficace, intégrée et réactive, en mettant en réseau les acteurs, en partageant les données et en agissant rapidement dès l’apparition de nouvelles menaces.
Allez plus loin avec ces deux vidéos
Les deux vidéos ci-dessous ont été produites par le projet Life RIPARIAS. Elles sont destinées aux gestionnaires de terrain, décideurs, scientifiques etc.
Gestion réussie des espèces exotiques envahissantes – Les étapes clés à ne pas manquer !
ManaIAS
Obligations, interdictions, procédures… que dit la loi ?
Il est interdit de :
- Introduire, élever, cultiver, vendre, transporter ou libérer dans la nature des espèces exotiques envahissantes réglementées.
Il est obligatoire de :
- Obtenir une dérogation de la Région pour détenir, sous des conditions strictes telles que le confinement, des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne dans un cadre scientifique ou pour des raisons d’intérêt public majeur.
- Obtenir une dérogation de la Région pour transporter des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne dans le cadre de leur éradication.






.jpg)
.jpg)



.jpg)